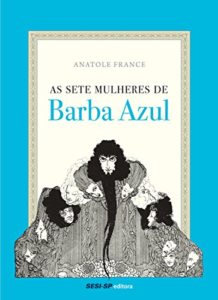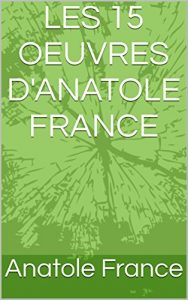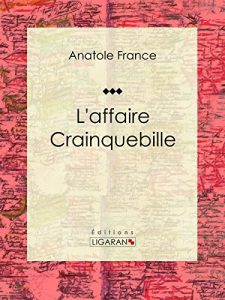Extrai:
En 1897, une affaire, qui touchait l’armée dans ses bureaux et ses conseils de guerre, émut le pays. Pour l’ardeur des passions qu’elle souleva, elle ne peut être comparée qu’à celle de la bulle Unigenitus, survenue cent soixante-quatorze ans auparavant et qui fut aussi, j’ai plaisir à le dire, une querelle des Français sur le juste et l’injuste. L’affaire de 1897, sortie d’un jugement secret, avait cela de dangereux, que le mystère dont elle était environnée favorisait le mensonge. À son origine, on trouve les antisémites qui travaillaient depuis quelques temps la France paisible. Et, qu’il se soit rencontré, par des temps calmes, chez un peuple aimable et tolérant, des hommes pour réveiller les vieilles haines de races et fomenter des guerres de religion, ce serait un sujet d’étonnement, si l’on ne savait d’où venaient ces hommes et si l’on ne reconnaissait en eux des missionnaires de l’Église Romaine. Aux antisémites se joignit bientôt un parti nombreux, le parti noir, qui, dans les salons, dans les faubourgs, dans les campagnes, semait des bruits sinistres, soufflait des nouvelles alarmantes, parlait de complot et de trahison, inquiétait le peuple dans son patriotisme, le troublait dans la sécurité, l’imbibait longuement de colère et de peur. Il ne se montrait pas encore au grand jour et formait dans l’ombre une masse immense et confuse, où l’on devinait comme une ressemblance avec les frocs cuirassés des moines de la Ligue. Mais, quand il eut rallié toutes les forces de la contre-révolution, attiré les innombrables mécontents de la République, soulevé enfin devant lui tout ce qu’un coup de vent de l’opinion peut emporter de poussière humaine, il dressa son front immense et bigarré, et prit le nom brillant de nationalisme.
La crédulité des foules est infinie. Séduit et furieux, le peuple, par masses énormes, se précipitait dans le piège des antisémites. Et les chefs de l’opinion républicaine, en trop grand nombre, l’y suivaient tristement. La législature s’achevait avec une sourde inquiétude, dans le silence d’un gouvernement dupe ou complice du parti noir et parmi lequel les nationalistes avaient pris des otages. Les élections générales approchant, les moines se découvrirent. Non qu’ils perdissent patience. La patience n’échappe jamais aux religieux. Mais ils rejetèrent toute prudence comme un bagage embarrassant et se lancèrent furieusement dans la lutte politique. Toute la milice romaine donna. Les congrégations non autorisées, se sentant les plus libres, agirent le plus audacieusement. Leur action était préparée de longue main. On retrouve dans toutes les choses ecclésiastiques la constance et la suite. Pour conquérir la domination temporelle en France, l’Église préférait, depuis quelques années, les corps francs, les congrégations non reconnues. Et la multitude de celles-ci augmentait sans cesse dans la France envahie.
En cette occasion, on revit ces vieux ennemis des puissances séculières, ces Petits Pères partout supprimés et partout répandus, les jésuites, dont l’avocat Pasquier disait, au temps d’Henri IV, qu’ils ne tendaient qu’à la désolation de l’État, les jésuites, « premiers boute-feux » de nos troubles. Qu’ils aient dirigé les entreprises des antisémites, au début de l’Affaire, ce n’est guère douteux. On les surprend ensuite nouant des intrigues dans les bureaux de la guerre pour sauver ces désespérés qui suaient le sang à étouffer la vérité. Aussi bien les jésuites y avaient-ils un intérêt sacré. Ils comptaient sur l’Affaire pour réparer le crime de l’Assemblée constituante, et fondaient cette espérance sur la trahison d’un juif qu’elle déterminerait la France indignée et épouvantée à retirer les droits civils aux juifs et aux protestants et à rétablir ainsi dans ses lois l’unité d’obédience au profit des catholiques romains. Il semble qu’ils aient pris moins de soin qu’à l’ordinaire de se cacher...
En 1897, une affaire, qui touchait l’armée dans ses bureaux et ses conseils de guerre, émut le pays. Pour l’ardeur des passions qu’elle souleva, elle ne peut être comparée qu’à celle de la bulle Unigenitus, survenue cent soixante-quatorze ans auparavant et qui fut aussi, j’ai plaisir à le dire, une querelle des Français sur le juste et l’injuste. L’affaire de 1897, sortie d’un jugement secret, avait cela de dangereux, que le mystère dont elle était environnée favorisait le mensonge. À son origine, on trouve les antisémites qui travaillaient depuis quelques temps la France paisible. Et, qu’il se soit rencontré, par des temps calmes, chez un peuple aimable et tolérant, des hommes pour réveiller les vieilles haines de races et fomenter des guerres de religion, ce serait un sujet d’étonnement, si l’on ne savait d’où venaient ces hommes et si l’on ne reconnaissait en eux des missionnaires de l’Église Romaine. Aux antisémites se joignit bientôt un parti nombreux, le parti noir, qui, dans les salons, dans les faubourgs, dans les campagnes, semait des bruits sinistres, soufflait des nouvelles alarmantes, parlait de complot et de trahison, inquiétait le peuple dans son patriotisme, le troublait dans la sécurité, l’imbibait longuement de colère et de peur. Il ne se montrait pas encore au grand jour et formait dans l’ombre une masse immense et confuse, où l’on devinait comme une ressemblance avec les frocs cuirassés des moines de la Ligue. Mais, quand il eut rallié toutes les forces de la contre-révolution, attiré les innombrables mécontents de la République, soulevé enfin devant lui tout ce qu’un coup de vent de l’opinion peut emporter de poussière humaine, il dressa son front immense et bigarré, et prit le nom brillant de nationalisme.
La crédulité des foules est infinie. Séduit et furieux, le peuple, par masses énormes, se précipitait dans le piège des antisémites. Et les chefs de l’opinion républicaine, en trop grand nombre, l’y suivaient tristement. La législature s’achevait avec une sourde inquiétude, dans le silence d’un gouvernement dupe ou complice du parti noir et parmi lequel les nationalistes avaient pris des otages. Les élections générales approchant, les moines se découvrirent. Non qu’ils perdissent patience. La patience n’échappe jamais aux religieux. Mais ils rejetèrent toute prudence comme un bagage embarrassant et se lancèrent furieusement dans la lutte politique. Toute la milice romaine donna. Les congrégations non autorisées, se sentant les plus libres, agirent le plus audacieusement. Leur action était préparée de longue main. On retrouve dans toutes les choses ecclésiastiques la constance et la suite. Pour conquérir la domination temporelle en France, l’Église préférait, depuis quelques années, les corps francs, les congrégations non reconnues. Et la multitude de celles-ci augmentait sans cesse dans la France envahie.
En cette occasion, on revit ces vieux ennemis des puissances séculières, ces Petits Pères partout supprimés et partout répandus, les jésuites, dont l’avocat Pasquier disait, au temps d’Henri IV, qu’ils ne tendaient qu’à la désolation de l’État, les jésuites, « premiers boute-feux » de nos troubles. Qu’ils aient dirigé les entreprises des antisémites, au début de l’Affaire, ce n’est guère douteux. On les surprend ensuite nouant des intrigues dans les bureaux de la guerre pour sauver ces désespérés qui suaient le sang à étouffer la vérité. Aussi bien les jésuites y avaient-ils un intérêt sacré. Ils comptaient sur l’Affaire pour réparer le crime de l’Assemblée constituante, et fondaient cette espérance sur la trahison d’un juif qu’elle déterminerait la France indignée et épouvantée à retirer les droits civils aux juifs et aux protestants et à rétablir ainsi dans ses lois l’unité d’obédience au profit des catholiques romains. Il semble qu’ils aient pris moins de soin qu’à l’ordinaire de se cacher...