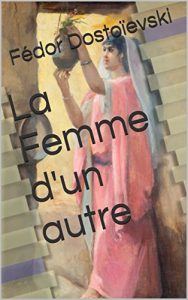Extrai:
C’était à la fin de novembre ; par un temps de dégel, humide et brumeux, le train de Varsovie arrivait à toute vapeur à Pétersbourg. Le brouillard était tel qu’à neuf heures du matin on voyait à peine clair ; à droite et à gauche de la voie ferrée il était difficile d’apercevoir quelque chose par les fenêtres du wagon. Dans le nombre des voyageurs, il y en avait bien quelques-uns qui revenaient de l’étranger, mais les voitures les plus remplies étaient celles de troisième classe, et les gens de peu qui les occupaient ne venaient pas de fort loin. Tous étaient fatigués, transis ; tous avaient les yeux appesantis par une nuit d’insomnie ; le brouillard mettait une pâleur jaunâtre sur tous les visages.
Depuis l’aurore, dans un des compartiments de troisième classe, se trouvaient assis en face l’un de l’autre, près de la même fenêtre, deux voyageurs, — tous deux jeunes, tous deux vêtus sans élégance, tous deux porteurs de physionomies assez remarquables, tous deux, enfin, désireux d’entrer en conversation ensemble. Si chacun d’eux avait su ce que son vis-à-vis offrait de particulièrement curieux en ce moment, ils se seraient sans doute étonnés du hasard étrange qui les avait mis en face l’un de l’autre dans un wagon de troisième classe, sur la ligne de Varsovie à Pétersbourg. L’un d’eux, âgé de vingt-sept ans, était de petite taille ; il avait des cheveux crépus et presque noirs, des yeux gris, petits, mais pleins de feu. Son nez était épaté, ses pommettes saillantes ; ses lèvres minces esquissaient continuellement un sourire effronté, moqueur et même méchant ; mais le front, haut et bien modelé, corrigeait l’impression déplaisante que produisait le bas de la figure. Ce qui frappait surtout dans ce visage, c’était sa pâleur cadavérique. Quoique le jeune homme fût d’une constitution assez robuste, cette pâleur donnait à l’ensemble de sa physionomie un air d’épuisement, et, en même temps, quelque chose de douloureusement passionné qui ne s’harmonisait ni avec le sourire impudent des lèvres, ni avec l’expression hardie et présomptueuse du regard. Chaudement enveloppé dans une large pelisse d’agneau, il n’avait pas eu froid la nuit, tandis que la fraîcheur nocturne de l’automne russe avait glacé son voisin, qui, évidemment, n’était pas préparé à l’affronter. Ce dernier avait sur lui un gros manteau pourvu d’un immense capuchon et privé de manches, comme en portent les touristes qui, en hiver, visitent la haute Italie ou la Suisse. Mais ce qui était bon pour voyager dans ces contrées devenait tout à fait insuffisant en Russie. Le possesseur de ce manteau, jeune homme de vingt-six ou vingt-sept ans, était d’une taille un peu au-dessus de la moyenne ; il avait des cheveux blonds et épais, des joues creuses, une petite barbe pointue et presque complètement blanche. Ses yeux étaient grands, bleus et fixes ; leur regard doux mais pesant offrait cette expression étrange qui révèle à certains observateurs un individu sujet aux attaques d’épilepsie. Le jeune homme avait des traits agréables, fins et délicats, mais son visage était pâle et même, en ce moment, bleui par le froid. Ses mains tenaient un petit paquet, — probablement tout son bagage, — enveloppé dans un vieux foulard passé de couleur. Ses pieds étaient chaussés de souliers aux semelles épaisses, et, — autre particularité contraire aux usages russes, — il portait des guêtres. L’homme à la pelisse d’agneau examina, un peu par désœuvrement, tout l’extérieur de son voisin, et à la fin lui adressa la parole.
— Vous êtes frileux ? demanda-t-il avec un haussement d’épaules.
En même temps, il avait sur les lèvres ce sourire inconvenant par lequel les gens mal élevés expriment quelquefois leur satisfaction à la vue des misères du prochain.
— Très-frileux, répondit avec un empressement extraordinaire l’interpellé, — et, remarquez, ce n’est encore que le dégel...
C’était à la fin de novembre ; par un temps de dégel, humide et brumeux, le train de Varsovie arrivait à toute vapeur à Pétersbourg. Le brouillard était tel qu’à neuf heures du matin on voyait à peine clair ; à droite et à gauche de la voie ferrée il était difficile d’apercevoir quelque chose par les fenêtres du wagon. Dans le nombre des voyageurs, il y en avait bien quelques-uns qui revenaient de l’étranger, mais les voitures les plus remplies étaient celles de troisième classe, et les gens de peu qui les occupaient ne venaient pas de fort loin. Tous étaient fatigués, transis ; tous avaient les yeux appesantis par une nuit d’insomnie ; le brouillard mettait une pâleur jaunâtre sur tous les visages.
Depuis l’aurore, dans un des compartiments de troisième classe, se trouvaient assis en face l’un de l’autre, près de la même fenêtre, deux voyageurs, — tous deux jeunes, tous deux vêtus sans élégance, tous deux porteurs de physionomies assez remarquables, tous deux, enfin, désireux d’entrer en conversation ensemble. Si chacun d’eux avait su ce que son vis-à-vis offrait de particulièrement curieux en ce moment, ils se seraient sans doute étonnés du hasard étrange qui les avait mis en face l’un de l’autre dans un wagon de troisième classe, sur la ligne de Varsovie à Pétersbourg. L’un d’eux, âgé de vingt-sept ans, était de petite taille ; il avait des cheveux crépus et presque noirs, des yeux gris, petits, mais pleins de feu. Son nez était épaté, ses pommettes saillantes ; ses lèvres minces esquissaient continuellement un sourire effronté, moqueur et même méchant ; mais le front, haut et bien modelé, corrigeait l’impression déplaisante que produisait le bas de la figure. Ce qui frappait surtout dans ce visage, c’était sa pâleur cadavérique. Quoique le jeune homme fût d’une constitution assez robuste, cette pâleur donnait à l’ensemble de sa physionomie un air d’épuisement, et, en même temps, quelque chose de douloureusement passionné qui ne s’harmonisait ni avec le sourire impudent des lèvres, ni avec l’expression hardie et présomptueuse du regard. Chaudement enveloppé dans une large pelisse d’agneau, il n’avait pas eu froid la nuit, tandis que la fraîcheur nocturne de l’automne russe avait glacé son voisin, qui, évidemment, n’était pas préparé à l’affronter. Ce dernier avait sur lui un gros manteau pourvu d’un immense capuchon et privé de manches, comme en portent les touristes qui, en hiver, visitent la haute Italie ou la Suisse. Mais ce qui était bon pour voyager dans ces contrées devenait tout à fait insuffisant en Russie. Le possesseur de ce manteau, jeune homme de vingt-six ou vingt-sept ans, était d’une taille un peu au-dessus de la moyenne ; il avait des cheveux blonds et épais, des joues creuses, une petite barbe pointue et presque complètement blanche. Ses yeux étaient grands, bleus et fixes ; leur regard doux mais pesant offrait cette expression étrange qui révèle à certains observateurs un individu sujet aux attaques d’épilepsie. Le jeune homme avait des traits agréables, fins et délicats, mais son visage était pâle et même, en ce moment, bleui par le froid. Ses mains tenaient un petit paquet, — probablement tout son bagage, — enveloppé dans un vieux foulard passé de couleur. Ses pieds étaient chaussés de souliers aux semelles épaisses, et, — autre particularité contraire aux usages russes, — il portait des guêtres. L’homme à la pelisse d’agneau examina, un peu par désœuvrement, tout l’extérieur de son voisin, et à la fin lui adressa la parole.
— Vous êtes frileux ? demanda-t-il avec un haussement d’épaules.
En même temps, il avait sur les lèvres ce sourire inconvenant par lequel les gens mal élevés expriment quelquefois leur satisfaction à la vue des misères du prochain.
— Très-frileux, répondit avec un empressement extraordinaire l’interpellé, — et, remarquez, ce n’est encore que le dégel...