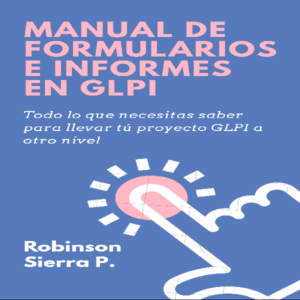En 1848, M. George d’Alfarey avait vingt-sept ans. C’était ce qu’on appelle dans le monde un jeune homme accompli. Une fortune convenable suffisait à ses goûts, et lui permettait de donner à sa vie une élégance sérieuse et sans futilité. D’une nature indépendante et légèrement sauvage, il n’avait choisi aucune carrière ; mais, pour satisfaire aux exigences de son esprit curieux, il avait cherché et trouvé dans l’étude des langues un apaisement aux besoins de travail qui le tourmentaient : il avait été l’un des auditeurs les plus assidus de Burnouf, et il était en correspondance familière avec le docteur L… de Berlin. Ses amis se moquaient un peu de lui et l’avaient surnommé George Pentecôte ; il les laissait rire et ne s’en penchait qu’avec plus d’ardeur sur les étranges alphabets que dessinent de leur calam les peuples de l’Asie.
Fils unique, rejeton plus rêvé qu’espéré d’un mariage tardif, il était né d’un père à cheveux blancs pour lequel il professait une tendresse respectueuse qui touchait de près à l’admiration. Le vieillard était demeuré dans le souvenir de son fils comme le type idéal de l’indulgence et de la fermeté. Il y avait en effet dans ses allures quelque chose de froid et de doux que pouvaient expliquer un grand mépris des hommes et l’habitude de la souffrance. C’était un ancien conventionnel rallié au régime impérial ; mais quoique le titre de comte et une dotation assez importante fussent venus solliciter son absolu dévouement, il avait su, chose rare à cette époque de servilité folle, conserver une certaine indépendance d’opinions sous ce gouvernement qui remplaça les libertés du pays par cette gloire despotique dont la fm s’écrivit si tristement dans les traités de 1815. La restauration rejeta violemment M. d’Alfarey dans la vie privée, où le repos qu’il avait espéré lui devint un insupportable ennui ; seul et sans famille, il voulut s’en créer une. Malgré les bons conseils de sa raison et de son expérience, il épousa une jeune fille de vingt ans qui avait quelque beauté, peu de fortune et un vif désir de s’entendre appeler madame la comtesse. La réaction était ardente en ce temps-là contre les idées libérales et impériales, qu’un compromis insensé avait confondues dans la même espérance, et M. d’Alfarey sentit, à l’accueil personnel qu’on lui fit lorsqu’il présenta sa femme dans le monde, que l’heure n’était point encore venue de sortir de sa retraite ; il s’enferma donc de nouveau, laissant à la jeune mariée une liberté dont elle usa parfois jusqu’à l’indiscrétion. Mme d’Alfarey sortait souvent seule le soir, et lorsqu’elle restait chez elle, un cercle de jeunes gens et de femmes à la mode s’empressait dans son salon. Elle avait bien quelques favoris parmi ceux qui l’entouraient, mais son vieux mari semblait ne rien remarquer ; il accueillait tout le monde avec la même politesse froide, où un observateur sagace aurait sans doute découvert une imperceptible nuance de résignation. Il parlait peu, n’écoutait guère les frivolités qui se débitaient devant lui, et ne se mêlait que très rarement à la conversation générale. Toutes les fois qu’on avait essayé de le faire causer sur les événemens extraordinaires auxquels il avait été mêlé, il était resté muet, repoussant les questions par un mot poli, mais n’y répondant pas. On riait bien un peu de lui, on plaignait volontiers Mme d’Alfarey d’être mariée à ce vieux jacobin, ainsi qu’on le nommait ; mais chacun lui témoignait en face un respect profond, qui n’était pas exempt d’une certaine crainte.
Fils unique, rejeton plus rêvé qu’espéré d’un mariage tardif, il était né d’un père à cheveux blancs pour lequel il professait une tendresse respectueuse qui touchait de près à l’admiration. Le vieillard était demeuré dans le souvenir de son fils comme le type idéal de l’indulgence et de la fermeté. Il y avait en effet dans ses allures quelque chose de froid et de doux que pouvaient expliquer un grand mépris des hommes et l’habitude de la souffrance. C’était un ancien conventionnel rallié au régime impérial ; mais quoique le titre de comte et une dotation assez importante fussent venus solliciter son absolu dévouement, il avait su, chose rare à cette époque de servilité folle, conserver une certaine indépendance d’opinions sous ce gouvernement qui remplaça les libertés du pays par cette gloire despotique dont la fm s’écrivit si tristement dans les traités de 1815. La restauration rejeta violemment M. d’Alfarey dans la vie privée, où le repos qu’il avait espéré lui devint un insupportable ennui ; seul et sans famille, il voulut s’en créer une. Malgré les bons conseils de sa raison et de son expérience, il épousa une jeune fille de vingt ans qui avait quelque beauté, peu de fortune et un vif désir de s’entendre appeler madame la comtesse. La réaction était ardente en ce temps-là contre les idées libérales et impériales, qu’un compromis insensé avait confondues dans la même espérance, et M. d’Alfarey sentit, à l’accueil personnel qu’on lui fit lorsqu’il présenta sa femme dans le monde, que l’heure n’était point encore venue de sortir de sa retraite ; il s’enferma donc de nouveau, laissant à la jeune mariée une liberté dont elle usa parfois jusqu’à l’indiscrétion. Mme d’Alfarey sortait souvent seule le soir, et lorsqu’elle restait chez elle, un cercle de jeunes gens et de femmes à la mode s’empressait dans son salon. Elle avait bien quelques favoris parmi ceux qui l’entouraient, mais son vieux mari semblait ne rien remarquer ; il accueillait tout le monde avec la même politesse froide, où un observateur sagace aurait sans doute découvert une imperceptible nuance de résignation. Il parlait peu, n’écoutait guère les frivolités qui se débitaient devant lui, et ne se mêlait que très rarement à la conversation générale. Toutes les fois qu’on avait essayé de le faire causer sur les événemens extraordinaires auxquels il avait été mêlé, il était resté muet, repoussant les questions par un mot poli, mais n’y répondant pas. On riait bien un peu de lui, on plaignait volontiers Mme d’Alfarey d’être mariée à ce vieux jacobin, ainsi qu’on le nommait ; mais chacun lui témoignait en face un respect profond, qui n’était pas exempt d’une certaine crainte.