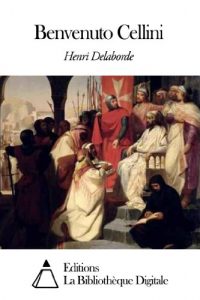Introduction :
La place que la mort de M. Paul Delaroche vient de laisser vide dans l’école française était, — qui songerait à le nier ? — une des plus importantes et des plus légitimement conquises. Quelles que soient d’ailleurs les inclinations de chacun, quelque prédilection que puissent inspirer des œuvres rivales, le nom de M. Delaroche n’en demeure pas moins dans la pensée de tous associé aux noms qui honorent le plus l’art contemporain, et, qu’on l’inscrive ou non avant tel autre personne à coup sûr ne lui marchandera le droit de figurer entre les premiers. Le peintre de l’Hémicycle du palais des Beaux-Artset de la Mort du duc de Guise a eu ce privilège de plaire à la foule en même temps qu’aux juges difficiles. Depuis l’époque de ses débuts jusqu’au dernier jour de sa vie, il a vu le succès lui venir de toutes parts et lui rester fidèle. Il n’a pas connu, comme Gros, son maître, comme Gérard, comme d’autres encore, ces cruels reviremens de l’opinion qui dépossèdent, au profit de réputations nouvelles, les réputations dès longtemps consacrées : rare bonne fortune dans un siècle où la gloire s’use vite, où les enthousiasmes, de la veille se changent le lendemain en indifférence, et quelquefois en outrages, où le talent enfin, s’il ne se transforme sans cesse, n’a plus à nos yeux qu’une valeur douteuse et un crédit suranné.
Pourquoi M. Delaroche a-t-il été excepté de cette loi d’ingratitude ou d’oubli qui a successivement pesé sur les maîtres les plus éminens de l’école moderne ? Comment, en continuant de marcher dans la voie qu’il s’était frayée d’abord, a-t-il réussi à ne pas lasser nos mobiles sympathies ? La nature de ce talent si aisément intelligible, le caractère dramatique des scènes représentées, peuvent jusqu’à un certain point expliquer sa longue popularité ; mais il convient de l’attribuer surtout aux efforts du peintre pour faire mieux chaque jour, à un redoublement de sévérité envers lui-même à mesure qu’il se sentait plus approuvé par l’opinion, en un mot à cette probité d’artiste que rien ne saurait ni décourager, ni endormir, et dont on trouverait difficilement ailleurs un plus noble exemple. Jamais homme moins que M. Delaroche ne se crut le droit de se reposer dans la célébrité et de s’accommoder en sûreté de conscience de la haute situation qu’il s’était faite ; jamais talent ne travailla plus obstinément à se châtier. C’est cette constance infatigable, c’est ce zèle de l’art et de tous les devoirs qu’il impose qui méritent d’être honorés chez M. Delaroche autant au moins que sa rare habileté. Tout en appréciant l’incontestable mérite des œuvres qu’il a laissées, on peut faire ses réserves et relever certaines imperfections dans la manière, certaines intentions plutôt littéraires que pittoresques : en face d’un caractère si digne, d’une vie si loyalement remplie, les restrictions ne sauraient être de mise, et le respect absolu n’est que justice.
La place que la mort de M. Paul Delaroche vient de laisser vide dans l’école française était, — qui songerait à le nier ? — une des plus importantes et des plus légitimement conquises. Quelles que soient d’ailleurs les inclinations de chacun, quelque prédilection que puissent inspirer des œuvres rivales, le nom de M. Delaroche n’en demeure pas moins dans la pensée de tous associé aux noms qui honorent le plus l’art contemporain, et, qu’on l’inscrive ou non avant tel autre personne à coup sûr ne lui marchandera le droit de figurer entre les premiers. Le peintre de l’Hémicycle du palais des Beaux-Artset de la Mort du duc de Guise a eu ce privilège de plaire à la foule en même temps qu’aux juges difficiles. Depuis l’époque de ses débuts jusqu’au dernier jour de sa vie, il a vu le succès lui venir de toutes parts et lui rester fidèle. Il n’a pas connu, comme Gros, son maître, comme Gérard, comme d’autres encore, ces cruels reviremens de l’opinion qui dépossèdent, au profit de réputations nouvelles, les réputations dès longtemps consacrées : rare bonne fortune dans un siècle où la gloire s’use vite, où les enthousiasmes, de la veille se changent le lendemain en indifférence, et quelquefois en outrages, où le talent enfin, s’il ne se transforme sans cesse, n’a plus à nos yeux qu’une valeur douteuse et un crédit suranné.
Pourquoi M. Delaroche a-t-il été excepté de cette loi d’ingratitude ou d’oubli qui a successivement pesé sur les maîtres les plus éminens de l’école moderne ? Comment, en continuant de marcher dans la voie qu’il s’était frayée d’abord, a-t-il réussi à ne pas lasser nos mobiles sympathies ? La nature de ce talent si aisément intelligible, le caractère dramatique des scènes représentées, peuvent jusqu’à un certain point expliquer sa longue popularité ; mais il convient de l’attribuer surtout aux efforts du peintre pour faire mieux chaque jour, à un redoublement de sévérité envers lui-même à mesure qu’il se sentait plus approuvé par l’opinion, en un mot à cette probité d’artiste que rien ne saurait ni décourager, ni endormir, et dont on trouverait difficilement ailleurs un plus noble exemple. Jamais homme moins que M. Delaroche ne se crut le droit de se reposer dans la célébrité et de s’accommoder en sûreté de conscience de la haute situation qu’il s’était faite ; jamais talent ne travailla plus obstinément à se châtier. C’est cette constance infatigable, c’est ce zèle de l’art et de tous les devoirs qu’il impose qui méritent d’être honorés chez M. Delaroche autant au moins que sa rare habileté. Tout en appréciant l’incontestable mérite des œuvres qu’il a laissées, on peut faire ses réserves et relever certaines imperfections dans la manière, certaines intentions plutôt littéraires que pittoresques : en face d’un caractère si digne, d’une vie si loyalement remplie, les restrictions ne sauraient être de mise, et le respect absolu n’est que justice.