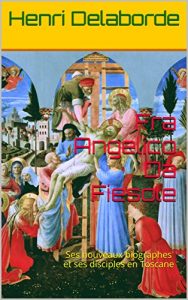Extrait :
Le temps n’est pas fort loin de nous où l’on dédaignait de remonter dans l’étude de l’art italien au-delà du siècle de Jules II et de Léon X, comme si aucune œuvre antérieure n’eût mérité d’être rapprochée des œuvres appartenant à la seconde phase de la renaissance. La régénération de la pointure et du goût à Florence ou à Rome semblait s’être accomplie sous une influence soudaine et par le seul fait de deux ou trois hommes miraculeusement inspirés : messies de l’art en quelque sorte, qui n’avaient pas eu de précurseurs. (Jolie ignorance systématique des premiers développemens de la peinture italienne n’est heureusement plus de mise aujourd’hui ; il se produit en Italie même un mouvement curieux, qui aura pour résultat, nous l’espérons, de remettre en pleine lumière tous les points d’une histoire, dont aucune phase n’est à négliger. Lorsque les chefs-d’œuvre du XVIe siècle ne nous apparaîtront plus isolés des essais qui les précédèrent, ils ne perdront rien de leurs droits à une immortelle admiration ; ils auront seulement une signification nouvelle, une origine plus vraisemblable, et peut-être l’intelligence plus complète de ces chefs-d’œuvre ne sera-t-elle pas sans influence sur les destinées de l’art contemporain. Quant à l’histoire de la peinture, elle gagnera certainement à élargir ainsi son horizon. L’ancienne école florentine fera mieux comprendre Raphaël, qui fut l’harmonieux résumé d’une succession déjà longue de découvertes et de progrès. Il ne sera plus permis de méconnaître dans les Donatello et les Verocchio les dignes maîtres de Léonard, et d’oublier ce que le plus indépendant des disciples. Michel-Ange lui-même, dut aux exemples de Luca Signorelli. Le Jugement dernier de la cathédrale d’Orviéto annonce et explique en effet la fresque de la chapelle Sixtine, comme certaines parties des Essais de Montaigne s’achèvent et prennent leur forme définitive sous la plume toute-puissante de Pascal.
Les grands peintres du XVIe siècle trouvèrent dans les travaux de leurs devanciers mieux que des erreurs à éviter ; ils y trouvèrent aussi des leçons. C’est ce qu’il est permis de dire à présent sans crainte de scandaliser personne. Bien plus : auprès de beaucoup de gens, un pareil aveu ne serait déjà qu’une confession incomplète de la vérité. Dans le domaine des arts comme ailleurs, le propre des réactions est d’aboutir vite à l’exagération de leur principe. Dès qu’on se lui occupé des maîtres Italiens primitifs, on n’accepta plus d’autres modèles, et, par un retour violent de l’opinion, on ne vit plus que les témoignages de la décadence de l’art là où chacun avait admiré les signes éclatans de sa renaissance. En Allemagne, toute une école s’est constituée qui prétend réduire les conditions de la peinture à l’imitation des formes et du style adoptés au moyen âge : noble école d’ailleurs, profondément spiritualiste et dont M. Overbeck est le chef respecté. L’entraînement n’a pas été aussi général en France, ni l’intolérance aussi manifeste. Pourtant, parmi les théoriciens de l’art comme parmi les artistes eux-mêmes, ce système rétrospectifs rencontre bon nombre de partisans : en ce qui concerne la décoration des édifices religieux par exemple, il a maintenant presque force de loi. Enfin, il n’est pas jusqu’à l’école anglaise, ordinairement si immobile dans ses tendances, qui ne se soit émue à son tour et n’ait eu ses préraphaélites. Les jeunes peintres qui s’intitulent ainsi ne se contentent pas de répudier le passé, et, — ce qui serait plus légitime encore. — les principes actuels de l’art national : ils nient les progrès faits en Italie après le Pérugin, tandis que des historiens et des critiques célèbrent à l’envi les maîtres dont les préraphaélites travaillent à s’assimiler la manière.
Seule, l’école italienne demeurait jusqu’ici en dehors du mouvement, bien qu’elle parut plus intéressée qu’aucune autre à y participer. Aujourd’hui elle y entre, non par des créations originales...
Le temps n’est pas fort loin de nous où l’on dédaignait de remonter dans l’étude de l’art italien au-delà du siècle de Jules II et de Léon X, comme si aucune œuvre antérieure n’eût mérité d’être rapprochée des œuvres appartenant à la seconde phase de la renaissance. La régénération de la pointure et du goût à Florence ou à Rome semblait s’être accomplie sous une influence soudaine et par le seul fait de deux ou trois hommes miraculeusement inspirés : messies de l’art en quelque sorte, qui n’avaient pas eu de précurseurs. (Jolie ignorance systématique des premiers développemens de la peinture italienne n’est heureusement plus de mise aujourd’hui ; il se produit en Italie même un mouvement curieux, qui aura pour résultat, nous l’espérons, de remettre en pleine lumière tous les points d’une histoire, dont aucune phase n’est à négliger. Lorsque les chefs-d’œuvre du XVIe siècle ne nous apparaîtront plus isolés des essais qui les précédèrent, ils ne perdront rien de leurs droits à une immortelle admiration ; ils auront seulement une signification nouvelle, une origine plus vraisemblable, et peut-être l’intelligence plus complète de ces chefs-d’œuvre ne sera-t-elle pas sans influence sur les destinées de l’art contemporain. Quant à l’histoire de la peinture, elle gagnera certainement à élargir ainsi son horizon. L’ancienne école florentine fera mieux comprendre Raphaël, qui fut l’harmonieux résumé d’une succession déjà longue de découvertes et de progrès. Il ne sera plus permis de méconnaître dans les Donatello et les Verocchio les dignes maîtres de Léonard, et d’oublier ce que le plus indépendant des disciples. Michel-Ange lui-même, dut aux exemples de Luca Signorelli. Le Jugement dernier de la cathédrale d’Orviéto annonce et explique en effet la fresque de la chapelle Sixtine, comme certaines parties des Essais de Montaigne s’achèvent et prennent leur forme définitive sous la plume toute-puissante de Pascal.
Les grands peintres du XVIe siècle trouvèrent dans les travaux de leurs devanciers mieux que des erreurs à éviter ; ils y trouvèrent aussi des leçons. C’est ce qu’il est permis de dire à présent sans crainte de scandaliser personne. Bien plus : auprès de beaucoup de gens, un pareil aveu ne serait déjà qu’une confession incomplète de la vérité. Dans le domaine des arts comme ailleurs, le propre des réactions est d’aboutir vite à l’exagération de leur principe. Dès qu’on se lui occupé des maîtres Italiens primitifs, on n’accepta plus d’autres modèles, et, par un retour violent de l’opinion, on ne vit plus que les témoignages de la décadence de l’art là où chacun avait admiré les signes éclatans de sa renaissance. En Allemagne, toute une école s’est constituée qui prétend réduire les conditions de la peinture à l’imitation des formes et du style adoptés au moyen âge : noble école d’ailleurs, profondément spiritualiste et dont M. Overbeck est le chef respecté. L’entraînement n’a pas été aussi général en France, ni l’intolérance aussi manifeste. Pourtant, parmi les théoriciens de l’art comme parmi les artistes eux-mêmes, ce système rétrospectifs rencontre bon nombre de partisans : en ce qui concerne la décoration des édifices religieux par exemple, il a maintenant presque force de loi. Enfin, il n’est pas jusqu’à l’école anglaise, ordinairement si immobile dans ses tendances, qui ne se soit émue à son tour et n’ait eu ses préraphaélites. Les jeunes peintres qui s’intitulent ainsi ne se contentent pas de répudier le passé, et, — ce qui serait plus légitime encore. — les principes actuels de l’art national : ils nient les progrès faits en Italie après le Pérugin, tandis que des historiens et des critiques célèbrent à l’envi les maîtres dont les préraphaélites travaillent à s’assimiler la manière.
Seule, l’école italienne demeurait jusqu’ici en dehors du mouvement, bien qu’elle parut plus intéressée qu’aucune autre à y participer. Aujourd’hui elle y entre, non par des créations originales...