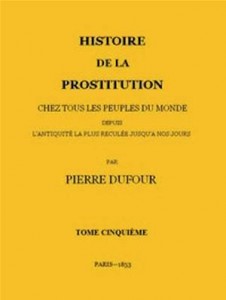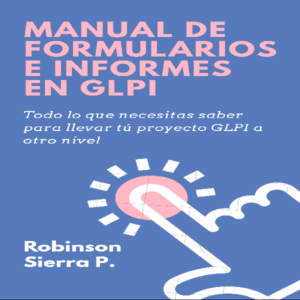Quels étaient les symptômes, quel fut le traitement médical du mal de Naples, dans les premiers [4]temps de son apparition? Il ne faut pas croire que ce mal horrible, qui passa d?abord pour incurable, ait eu, à son début, le même caractère, le même aspect, qu?à l?époque de sa décroissance et de sa période stationnaire. On pourrait dire, sans craindre d?avancer un paradoxe, que la maladie, à quelques exceptions près et hors de certaines circonstances excentriques, est redevenue aujourd?hui ce qu?elle était avant le monstrueux accouplement de la lèpre et du virus vénérien. Dès l?année 1540, selon le témoignage de Guicchardin qui avait rapporté l?origine de l?épidémie à l?année 1494, le mal «s?était fort adouci et s?était changé lui-même en plusieurs espèces différentes de la première.» Dans les commencements, c?est-à-dire dans la période de temps qui suivit l?explosion subite et presque universelle de ce mal inconnu que les médecins considéraient comme une pestilence, les symptômes étaient bien dignes de l?effroi qu?ils inspiraient, et l?on comprend que, dans tous les pays où la maladie avait éclaté, des règlements de police, imités de ceux qu?on avait jadis mis en vigueur contre la lèpre, retranchassent de la société des vivants les malheureuses victimes de cette peste honteuse. On supposait, d?ailleurs, que la contagion était plus immédiate, plus prompte, plus inévitable que dans toute autre maladie contagieuse; on ne savait pas non plus si la transmission du mal s?opérait seulement par la conjonction charnelle; on s?imaginait [5]que l?haleine, le regard même d?un vérolé pouvait communiquer l?infection. Tous les médecins qui ont observé la maladie entre les années 1494 et 1514, qu?on attribue à sa première période d?invasion et de développement, semblent épouvantés de leurs propres observations; ils s?accordent et se répètent à peu près dans la description des symptômes syphilitiques, qui pouvaient ne pas se rencontrer également chez tous les malades, mais qui formaient néanmoins la constitution primitive du mal de Naples. Jérôme Fracastor a résumé admirablement les traités de Léoniceno, de Torrella, de Cataneo et d?Almenar, ses contemporains, dans son livre De Morbis contagiosis, où il décrit les symptômes qu?il avait pu observer lui-même, lorsqu?il étudiait la médecine et professait la philosophie à l?université de Vérone. Fracastor résume en ces termes la peinture affreuse du mal de Naples à son origine: «Les malades étaient tristes, las et abattus; ils avaient le visage pâle. Il venait, chez la plupart, des chancres aux parties honteuses: ces chancres étaient opiniâtres; quand on les avait guéris dans un endroit, ils apparaissaient dans un autre, et c?était toujours à recommencer. Il s?élevait ensuite, sur la peau, des pustules avec croûte: elles commençaient, dans les uns, par attaquer la tête, et c?était le plus ordinaire; dans les autres, elles paraissaient ailleurs. D?abord elles étaient petites, ensuite elles augmentaient peu à peu jusqu?à [6]la grosseur d?une coque de gland, dont elles avaient la figure; d?ailleurs, assez semblables aux croûtes de lait des enfants; dans quelques-uns, ces pustules étaient petites et sèches; dans d?autres, elles étaient grosses et humides; dans les uns, livides; dans les autres, blanchâtres et un peu pâles; dans d?autres, dures et rougeâtres. Elles s?ouvraient au bout de quelques jours et rendaient continuellement une quantité incroyable d?une liqueur puante et vilaine. Dès qu?elles étaient ouvertes, c?étaient de vrais ulcères phagédéniques, qui consumaient non-seulement les chairs, mais même les os. Ceux dont les parties supérieures étaient attaquées, avaient des fluxions malignes, qui rongeaient tantôt le palais, tantôt la trachée artère, tantôt le gosier, tantôt les amygdales. Quelques-uns perdaient les lèvres; d?autres, le nez; d?autres, les yeux; d?autres, toutes les parties honteuses. Il venait à un grand nombre, dans les membres, des tumeurs gommeuses qui les défiguraient, et qui étaient souvent de la grosseur d?un ?uf ou d?un petit pain. Quand elles s?ouvraient, il en sortait une liqueur blanche et mucilagineuse. Elles attaquaient principalement les bras et les jambes; quelquefois, elles s?ulcéraient; d?autres fois, elles devenaient calleuses jusqu?à la mort. Mais, comme si cela n?eût pas suffi, il survenait encore, dans les membres, de grandes douleurs; souvent, en même temps que les pustules; quelquefois, plus tôt, et d?autres fois, plus tard. Ces [7]douleurs, qui étaient longues et insupportables, se faisaient sentir principalement dans la nuit, et n?occupaient pas proprement les articulations, mais le corps des membres et les nerfs. Quelques-uns néanmoins avaient des pustules sans douleurs; d?autres, des douleurs sans pustules; la plupart avaient des pustules et des douleurs. Cependant tous les membres étaient dans un état de langueur; les malades étaient maigres et défaits, sans appétit, ne dormaient point, étaient toujours tristes et de maussade humeur, et voulaient toujours demeurer couchés. Le visage et les jambes leur enflaient. Une petite fièvre se mettait quelquefois de la partie, mais rarement. Quelques-uns souffraient des douleurs de tête, mais des douleurs longues, et qui ne cédaient à aucun remède.» Nous regrettons d?avoir employé la traduction lourde et incorrecte du bonhomme Jault, qui, pour avoir été faite sous les yeux d?Astruc, donne une bien faible idée du style ferme, élégant et poétique de Fracastor, mais nous voulions laisser à un homme de l?art le soin de donner ici une traduction médicale plutôt que littéraire. Conçoit-on, après la lecture de cette description si caractéristique, que le savant Fracastor ait nié, dans le même ouvrage, l?analogie frappante qui existait entre la lèpre et le mal de Naples? Le dernier, n?étant qu?une complication de la lèpre sous l?influence du virus vénérien, devait avoir des rapports intimes avec la peste inguinale du sixième [8]siècle et le mal des ardents, du neuvième, qui ne furent aussi que des transformations épidémiques de l?éléphantiasis. Mais le mal de Naples, à partir de l?année 1514, eut aussi ses métamorphoses, causées sans doute par ce que nous nommerons le croisement des races de la maladie. Jean de Vigo cite le premier les squirres osseux qui survenaient chez les malades, un an au moins après d?atroces douleurs internes dans tous les membres. Ces squirres, qui tourmentaient beaucoup le patient, surtout pendant la nuit, aboutissaient toujours à la carie de l?épine dorsale. Pierre Manardi, qui traitait avec habileté les maladies syphilitiques, vers le même temps que Jean de Vigo (1514 à 1526), signale de nouveaux symptômes qui dénotent le virus vénérien: «Le principal signe du mal français, dit-il au chapitre 4 de son traité De Morbo gallico, consiste en des pustules qui viennent à l?extrémité de la verge chez les hommes, à l?entrée de la vulve ou au col de la matrice chez les femmes, et en une démangeaison aux parties qui contiennent la semence. Le plus souvent ces pustules s?ulcèrent; je dis le plus souvent, parce que j?ai vu des malades chez qui elles s?étaient durcies comme des verrues, des clous et des poireaux.» Il paraît que, durant cette seconde période, le mal de Naples, malgré quelques variations symptomatiques, conserva toute son intensité. Mais, de 1526 à 1540, il entra dans une période décroissante, quoique le mal vénérien se dessinât [9]davantage par la tumeur des glandes inguinales et par la chute des cheveux. «Quelquefois le virus se jette sur les aines et en tuméfie les glandes, dit un médecin français, Antoine Lecocq, qui publia en 1540 son opuscule De Ligno sancto; si la tumeur suppure, c?est souvent un bien. Cette maladie s?appelle bubon; d?autres la nomment poulain, par un trait de raillerie contre ceux qui en sont attaqués, d?autant qu?ils marchent en écartant les jambes comme s?ils étaient à cheval.» Quant à la chute des cheveux et des poils, on doit l?attribuer moins à la maladie qu?au traitement mercuriel qu?on lui faisait subir. «Depuis environ six ans, disait Fracastor en 1546, la maladie a encore changé considérablement. On ne voit maintenant des pustules, que dans très-peu de malades, presque point de douleurs ou des douleurs bien plus légères, mais beaucoup de tumeurs gommeuses. Une chose qui a étonné tout le monde, c?est la chute des cheveux et des autres poils du corps..... Il arrive encore pis à présent: les dents branlent à plusieurs, et tombent même à quelques-uns.» C?était là évidemment la conséquence de l?emploi du mercure dans la médication italienne; mais, en France, où l?usage des remèdes végétaux et surtout du bois de gaïac avait prévalu, les accidents de la maladie différaient d?une manière essentielle, qui nous permet d?avancer que le mal de Naples, en s?éloignant de sa source, était redevenu exclusivement vénérien et s?était dégagé de la lèpre, [10]ou du farcin, ou de toute autre affection contagieuse avec laquelle il avait fait une alliance adultère. Nous ne suivrons pas plus loin les dégénérescences du mal de Naples; nous avons voulu seulement faire comprendre que la lèpre persistait toujours sous le masque de ce mal nouveau, et que les climats, les tempéraments, les circonstances locales agissaient intimement sur les causes et les effets de la maladie. Il était inutile de démontrer autrement quelle terrible action devait avoir la débauche publique, à cette époque, sur la santé de ceux qui s?y livraient. On ne niera pas que le mal était d?une nature si communicative, que la contagion pouvait exister, dans une foule de cas, sans que l?acte vénérien lui servît de véhicule; on conçoit donc que si le fléau pénétrait, on ne sait par quelle voie, dans l?intérieur des ménages honnêtes, il devait être inévitablement attaché aux faits et gestes de la Prostitution. La fréquentation des femmes de mauvaise vie ne fut jamais plus dangereuse que dans les cinquante années qui suivirent la première apparition du fléau, car on ne s?avisa que fort tard de soupçonner que ce fléau, né d?un commerce impur quelconque, se transmettait plus rapidement et plus sûrement par les rapports sexuels, que par tout autre contact ou accointance. Les m?urs étaient plus régulières en France qu?en Italie, et les débauchés, pour les besoins de qui on laissait ouverts les lieux de Prostitution, vivaient[11]absolument en dehors de la vie commune. Ce fut parmi eux que le mal de Naples exerça d?abord ses fureurs et ses ravages, sans que la médecine et la chirurgie daignassent s?occuper d?eux et leur donner des soins, qu?on jugeait inutiles pour le malade et honteux pour le praticien. Quelques écoliers mal famés, des apothicaires, de vieilles entremetteuses, qui se faisaient largement payer leurs consultations et leurs drogues, s?aventurèrent à traiter les pauvres vérolés, comme on les appelait, et ils opérèrent quelques guérisons à l?aide de recettes empiriques connues de temps immémorial pour le traitement des maladies pustuleuses. Mais ce n?est qu?en 1527, qu?un véritable médecin, Jacques de Bethencourt, osa se compromettre, au point de publier des recherches et des conseils sur la syphilis dans un petit livre intitulé Nouveau Carême de pénitence ou purgatoire du mal vénérien (Nova penitentialis Quadragesima necnon purgatorium in morbum gallicum seu venereum). Avant Jacques de Bethencourt, un seul médecin français, qui a gardé l?anonyme, s?était aventuré à joindre un remède contre la grosse vérole à sa paraphrase française du Regimen sanitatis d?Arnoul de Villeneuve, publié à Lyon en 1501. On aurait pu penser, à voir combien l?art restait étranger au mal de Naples, que ce mal formidable n?avait pas encore pénétré en France, tandis qu?il s?y était partout répandu, malgré tous les efforts de l?autorité religieuse, politique et municipale. Il faut [12]faire observer cependant que la maladie attaquait rarement les honnêtes gens, et qu?elle se concentrait, pour ainsi dire, dans les classes réprouvées de la société, parmi les femmes et les hommes de mauvaise vie, les vagabonds, les mendiants, les truands et les infâmes hôtes des Cours des Miracles. On trouve, dans les registres du parlement de Paris, à la date du 6 mars 1497, une ordonnance qui nous apprend que l?évêque de Paris (c?était alors un prélat vénérable, nommé Jean Simon) avait pris l?initiative des mesures de salubrité, que réclamait la propagation de la grosse vérole. Cette maladie contagieuse, «qui, puis deux ans en çà, a eu grant cours en ce royaume, dit l?ordonnance, tant de ceste ville de Paris, que d?autres lieux,» faisait craindre aux hommes de l?art, qu?elle ne se multipliât encore à la faveur du printemps. En conséquence, l?évêque avait convoqué, à l?évêché, les officiers du roi en Châtelet, pour leur soumettre ses appréhensions à cet égard; il fut décidé qu?on en référerait au parlement, et la Cour, s?étant réunie pour délibérer, commit un de ses conseillers Martin de Bellefaye et son greffier, pour seconder les vues charitables de l?évêque, et pour s?entendre à ce sujet avec le prévôt de Paris. Le parlement rendit une ordonnance qui fut publiée dans les rues et carrefours, et qui renfermait la police concernant la maladie nouvelle. Cette police avait été discutée, en présence de l?évêque de Paris, par plusieurs [13]grands et notables personnages de tous estatz. Les étrangers, tant hommes que femmes, malades de la grosse vérole, devaient sortir de la ville, vingt-quatre heures après la publication de l?ordonnance, sous peine de la hart; qu?ils retournassent, soit dans leur pays natal, soit dans l?endroit où ils faisaient leur résidence quand la maladie les avait attaqués. Pour faciliter leur prompt départ, on délivrerait à chacun d?eux, lorsqu?ils sortiraient par les portes Saint-Denis ou Saint-Jacques, la somme de 4 sols parisis, en prenant leur nom par écrit et en leur faisant défense de rentrer dans la ville, avant leur guérison. Quant aux malades qui résidaient et demeuraient à Paris lorsqu?ils avaient été atteints de la maladie, injonction leur était faite de se retirer dans leurs maisons, «sans plus aller par la ville, de jour et de nuit,» sous peine de la hart. Si ces malades, relégués dans leur domicile, étaient pauvres et indigents, ils pouvaient se recommander aux curés et marguilliers de leurs paroisses, qui les pourvoiraient de vivres. Au contraire, les malades, qui n?auraient pas d?asile, étaient sommés de se retirer au faubourg de Saint-Germain-des-Prés, où une maison avait été louée et disposée pour leur servir d?hôpital. D?autres demourances seraient préparées ailleurs pour les pauvres femmes malades, qui étaient moins nombreuses que les hommes, mais qui par honte cachaient sans doute aussi longtemps que possible leur état de santé. On prévoyait déjà [14]que l?hospice provisoire de Saint-Germain-des-Prés ne suffirait pas, à cause de l?augmentation du nombre des malades, et l?on promettait d?y adjoindre des granges et autres lieux voisins de cet hospice, afin de recevoir tous les pauvres qui se présenteraient pour se faire panser. Les dépenses de ces nouvelles maladreries étaient à la charge de la ville, dans laquelle on ferait des quêtes et où l?on établirait au besoin un impôt spécial. Deux agents comptables devaient être placés, l?un à la porte Saint-Jacques, l?autre à la porte Saint-Denis, pour délivrer les 4 sols parisis et pour inscrire les noms de ceux qui toucheraient cette indemnité, en sortant de la ville; des surveillants seraient placés à toutes les portes de Paris, pour que les malades n?y rentrassent pas apertement ou secrètement. L?article le plus important de l?ordonnance est le huitième, ainsi conçu: «Item, sera ordonné par le prévost de Paris, aux examinateurs et sergents, que, ès quartiers dont ils ont la charge, ils ne souffrent et permettent aucuns d?iceulx malades aller, converser ou communiquer parmi la ville. Et où ils en trouveront aucuns, ils les mettent hors d?icelle ville, ou les envoient et mènent en prison, pour estre pugnis corporellement, selon ladite ordonnance.» Cet article prouve que la grosse vérole était regardée comme une sorte de peste, et que, dès cette époque, on avait organisé dans Paris un service de santé avec desexaminateurs et des sergents, attachés [15]à chaque quartier de la ville, et chargés de faire observer rigoureusement les règlements sanitaires. Cependant, on ne croyait pas à l?infection de l?air durant le règne de la maladie, puisque les malades sont autorisés à rester dans la ville, pourvu qu?ils soient enfermés chez eux. Il est probable que les maisons où logeaient des malades étaient signalées à l?attention publique par quelque signe extérieur, tel qu?une botte de paille suspendue à une des fenêtres, ou bien une croix de bois noir clouée à la porte. Une désignation de ce genre fut du moins exigée de ceux qui habiteraient des maisons infectées de peste, par une ordonnance du prévôt de Paris, en date du 16 novembre 1510. Quoique cette ordonnance et celles d?une date postérieure, relatives aux épidémies, ne prescrivent aucune mesure de prudence à l?égard des lieux de débauche, il est certain qu?on les faisait évacuer et qu?on en scellait la porte jusqu?à ce que la santé publique fût améliorée. Il en était de même des étuves, qu?on fermait pendant toute la durée de la contagion. Dans le cours du printemps de 1497, le nombre des malades de la grosse vérole s?accrut considérablement, selon les prévisions du bon évêque. «Le vendredi 5 mai, la Cour de parlement prélevoit une somme de 60 livres parisis (environ 300 fr. de notre monnaie) sur le fonds des amendes, et faisoit remettre cette somme à sire Nicolas Potier et autres, commis touchant le faict des malades de Naples, pour icelle [16]somme estre employée ès affaires et necessitez desdits malades.» Les registres du parlement, où nous trouvons ce fait consigné, mentionnent aussi, à la date du 27 mai de la même année, des remontrances que l?évêque de Paris adressa derechef à Messieurs, pour leur demander une aumône en pitié, attendu que, si, des malades reçus dans l?hospice du faubourg Saint-Germain, «y en avoit de garis en bien grant nombre,» les autres souffraient de cruelles privations, car «l?argent estoit failly et y faisoit l?on de petites aumosnes pour le présent.» Le greffier de la Cour offrit de consacrer à ces ?uvres pitéables quinze ou seize écus (environ 200 fr.), qui étaient déposés au greffe au moins depuis dix ans, et qu?on n?avait jamais réclamés. La Cour ordonna de remettre cette somme à l?évêque. Ce document prouve que la charité publique commençait à se lasser, probablement parce que la cause ordinaire de la maladie n?était pas faite pour édifier les bonnes âmes. Quant aux malades guéris, il est à présumer que ce n?étaient point de véritables vénériens, et que bien des mendiants s?étaient fait passer pour malades sans l?être, afin de participer au bénéfice des 4 sols parisis. En effet, les espérances qu?on aurait pu concevoir d?après la lettre de l?évêque au parlement, ne se réalisèrent pas, et les nombreuses guérisons que cette lettre annonçait amenèrent un surcroît de malades. La population saine de Paris s?effraya et demanda hautement l?expulsion de ces étranges pestiférés, [17]qui faisaient horreur à voir. Le prévôt de Paris se rendit à ces réclamations unanimes, et il fit crier à son de trompe l?ordonnance suivante (regist. bleu du Châtelet, fol. 3): «Combien que par cy devant ait été publié, crié et ordonné à son de trompe et cry public, par les carrefours de Paris, à ce qu?aucun n?en peut prétendre cause d?ignorance: que tous les malades de la grosse vérole vuidassent incontinent hors la ville et s?en allassent, les étrangers ès lieux dont ils sont natifs, et les autres vuidassent hors la ville, sur peine de la hart: néanmoins, lesdits malades, en contemnant lesdits crys, sont retournez de toutes parts et conversent parmi la ville avec les personnes saines, qui est chose dangereuse pour le peuple et la seigneurie qui à présent est à Paris. L?on défend derechef, de par le roy et monsieur le prévost de Paris, à tous lesdits malades de ladite maladie, tant hommes que femmes, que incontinent après ce présent cry, ils vuident et se départent de ladite ville et forsbourgs de Paris, et s?en voisent (s?en aillent), savoir lesdits forains faire leur résidence ès pays et lieux dont ils sont natifs, et les autres hors ladite ville et forsbourgs, sur peine d?estre jectez en la rivière, s?ils y sont prins, le jourd?hui passé. Enjoint l?on à tous commissaires, quarteniers et sergents, prendre ou faire prendre ceulx qui seront trouvez, pour en faire exécution. Fait le lundy 25e jour de juin l?an 1498.» Cette ordonnance, qui n?admettait ni excuse, ni délai, [18]ni exception, avait été motivée par la présence à Paris de toute la noblesse (seigneurie), qui venait offrir ses hommages au nouveau roi Louis XII, et qui s?effrayait de la rencontre des malades, que l?on avait bien de la peine à retenir dans leurs maisons; car leur mal, si horrible qu?il fût, ne les empêchait pas de se donner du mouvement et de l?air. On avait fermé les yeux sur les infractions aux lois de police, quand ces malades étaient des bourgeois aisés et bien apparentés, mais leur aspect avait de quoi faire détester la ville à quiconque les voyait apparaître comme des pourritures vivantes: «Ce n?étoient qu?ulcères sur eux, dit Sauval en s?appropriant les expressions de Fernel, et qu?on auroit pris pour du gland, à en juger par la grosseur et par la couleur, d?où sortoit une boue vilaine et infecte qui faisoit bondir le c?ur; ils avoient le visage haut, d?un noir verdâtre, d?ailleurs si couvert de plaies, de cicatrices et de pustules, qu?il ne se peut rien voir de plus hideux.» (Antiq. de Paris, t. III, p. 27.) Le savant Fernel, qui vivait à la fin du seizième siècle, ajoute que cette première maladie vénérienne ressemblait si peu à celle de son temps, qu?on a peine à croire que ce fût la même. «Icelle maladie, disait en 1539 l?auteur pseudonyme du Triumphe de très-haulte et très-puissante dame Vérole, a remis beaucoup de sa férocité et aigreur première, et n?en sont les peuples si travaillez, qu?ils souloient.» [19]L?arrêt du parlement du 6 mars 1497 (sa date est de l?année 1496, suivant le calendrier pascal) ne permet pas de douter que le mal de Naples ait régné dans tout le royaume depuis l?année 1494, mais on n?a pas encore recherché l?époque de l?invasion dans chaque province et dans chaque ville. Les archives municipales et consulaires fourniraient des documents précis à cet égard. Astruc, dans son grand traité monographique, a cité seulement deux faits qui constatent l?introduction du mal de Naples à Romans en Dauphiné et au Puy en Velay, dans l?année 1496: «La maladie de las bubas, disent les registres de l?université de Manosque, a été apportée cette année par certains soldats de Romans en Dauphiné, qui étoient au service du roy et de l?illustrissime duc d?Orléans, dans la ville, leur patrie, qui étoit encore saine et qui ne connoissoit point cette sorte de maladie, laquelle ne régnoit point encore dans la Provence.» Dans une chronique inédite de la ville du Puy en Velay, l?auteur, Estève de Mèges, bourgeois de cette ville, rapporte que la grosse vérole a paru pour la première fois, au Puy, dans le cours de l?année 1496. L?extrait des registres de Manosque est très-précieux en ce qu?il sert à prouver que l?armée de Charles VIII, au retour de l?expédition de Naples, était infectée de la nouvelle maladie, et, en effet, cette maladie s?est manifestée, en l?année 1495, sur toute la route que parcouraient les débris de cette armée, qui rentrait en France, par [20]bandes désorganisées, après la bataille de Fornoue. Les soldats qui apportèrent le mal de Naples à Romans avaient fait partie sans doute de l?arrière-garde, qui s?enferma dans Novare avec le duc d?Orléans, et qui y soutint un siége mémorable pendant plusieurs mois. Depuis l?époque où Astruc recueillait les matériaux de son encyclopédie des maladies vénériennes, une étude plus consciencieuse des archives municipales, sur tous les points de la France, a permis de constater que le mal de Naples s?était étendu de ville en ville et jusqu?au fond des plus petits hameaux dès l?année 1494, ce qui s?accorde avec l?arrêt du parlement de Paris, où il est dit, à la date du 6 mars 1497, que «la grosse vérole a eu grant cours en ce royaume, puis deux ans en çà (c?est-à-dire en 1495 et 1496).» Dans les grandes villes seulement, à l?exemple de Paris, on usa de rigueur contre les malades, on les chassa en les menaçant du fouet ou de la potence; mais, ailleurs, on se contenta de les éviter et de les fuir, on les laissa mourir en paix. Nous ne croyons pas, comme l?assure plus d?un contemporain, que la vingtième partie de la population fut enlevée par l?épidémie, en France et en Europe; mais, comme l?écrivait Antoine Coccius Sabellicus en 1502: «Peu des gens en moururent, eu égard au grand nombre des malades, mais beaucoup moins de malades s?en guérirent.» Ulric de Hutten, qui s?était cru guéri et qui succomba aux progrès latents du mal à l?âge de [21]trente-six ans, disait lui-même que, sur cent malades, à peine en guérissait-on un seul, et encore retombait-il le plus souvent dans un état pire que le premier. (De Morbi gall. curatione, cap. 4.) Car la vie était plus affreuse que la mort, pour ces malheureux, qui n?avaient pas droit de vivre dans la société de leurs semblables, et qui ne trouvaient ni remède physique ni soulagement moral à leurs atroces souffrances. Dans les premiers temps de l?apparition du mal de Naples, on peut dire qu?il ne fut traité nulle part selon les règles de l?art; les médecins s?abstenaient presque partout, en déclarant, à l?instar de Barthélemi Montagnana, professeur de médecine à la Faculté de Padoue, que ce mal était inconnu à Hippocrate, à Galien, à Avicenne et autres anciens médecins; ils avaient, d?ailleurs, un préjugé d?aversion insurmontable contre la lèpre, à laquelle survivait la syphilis. En outre, ce mal honteux semblait se concentrer dans la classe abjecte, qui couvait tant de vilaines infirmités dans son sein, et il n?y aurait eu que peu d?avantages à retirer du traitement de ces infirmités, nées du vice, de la misère et de la crapule. «Dans la cure des maladies, disaient-ils en se drapant dans leur majesté doctorale, la première indication devant être prise de l?essence même de la maladie, on ne pouvait tirer aucun indice d?un mal qui était absolument inconnu.» Les médecins français se montrèrent plus indifférents ou plus ignorants encore [22]que ceux d?Allemagne et d?Italie: ils abandonnèrent entièrement aux charlatans de toute espèce la curation de ce mal qui leur semblait un problème insoluble. Ce fut cette désertion générale des hommes de l?art, qui fit intervenir une foule d?intrus dans le traitement vénérien; après les barbiers et les apothicaires, on vit les étuvistes, les baigneurs, les cordonniers et les savetiers se changer en opérateurs. De là, tant de drogues diverses, tant de méthodes différentes, tant d?essais infructueux, tant de procédés ridicules, avant qu?on osât employer le mercure ou vif-argent, avant qu?on eût connaissance des vertus du bois de gaïac. La saignée, les lavements, les emplâtres, les purgatifs, les tisanes jouaient leur rôle plus ou moins neutre, comme dans la plupart des maladies; mais les frictions, les bains et les sudorifiques réussissaient mieux, du moins en apparence. «Le meilleur moyen que j?ai trouvé de guérir les douleurs et même les pustules, écrivait Gaspard Torrella, qui avait expérimenté en France cette médication anodine, c?est de faire suer le malade dans un four chaud ou du moins dans une étuve, pendant quinze jours de suite, à jeun.» On faisait aussi, en France, un prodigieux usage de la panacée qu?on prétendait tirer de la vipère: vin où on avait laissé mourir et infuser des vipères; bouillon de vipères; chair de vipère, bouillie ou rôtie; décoction de vipères, etc. Ce furent les chirurgiens qui se servirent du mercure pour obtenir [23]un traitement énergique contre un mal qu?on voyait résister à tout. Le succès répondit à leur hardiesse, mais l?ignorance ou l?imprudence des opérateurs, qui usèrent du mercure à forte dose, occasionna des accidents terribles, et plusieurs malades, qui ne fussent pas morts de la maladie, moururent du remède. Gaspard Torrella attribue aux effets du mercure la mort du cardinal de Segorbe et d?Alphonse Borgia. On chercha donc un remède moins dangereux et plus certain; on crut l?avoir trouvé, quand le hasard fit découvrir en Amérique les propriétés antisyphilitiques du bois de gaïac. Ulric de Hutten, qui avait éprouvé un des premiers la puissance de ce remède, raconte qu?un gentilhomme espagnol, trésorier d?une province de l?île de Saint-Domingue, étant fort malade du mal français, apprit d?un indigène le remède qu?il fallait employer contre ce mal, et apporta en Europe la recette qui lui avait rendu la santé. Ulric de Hutten place en 1515 ou 1517 l?importation du gaïac en Europe. Ce fait est rapporté différemment, d?après les traditions locales, dans les notes des curieux Voyages de Jérôme Benzoni (édit. de Francfort, 1594): «Un Espagnol, qui avoit pris la vérole avec une concubine indienne et qui souffroit de cruelles douleurs, ayant bu de l?eau de gaïac que lui donna un serviteur indien qui faisoit le médecin, fut non-seulement délivré de ses douleurs, mais encore parfaitement guéri.» [24]Depuis cette époque (1515 à 1517), on publia, par toute l?Europe, que le mal de Naples pouvait enfin se guérir avec une drogue que fournissait l?Amérique, et dès lors le peuple, qui fait d?étranges confusions dans ses chroniques orales, se persuada que le remède et le mal devaient être originaires du même pays. Les noms de mal de Naples et de mal français ne pouvaient survivre longtemps à cette préoccupation qui mettait le berceau du mal auprès de l?arbre qui le guérissait; les noms de grosse vérole et de vérole, par excellence, prévalurent, pour restituer à l?Amérique ce qu?on pensait lui appartenir. Les premières cures dues à l?usage du bois de gaïac furent merveilleuses. Nicolas Poll, médecin de Charles-Quint, affirme que trois mille malades désespérés furent guéris presque à la fois, sous ses yeux, grâce à la décoction de gaïac, et que leur guérison ressemblait à une résurrection. Le grand Érasme, qui avait été attaqué d?une syphilis terrible avec douleurs frénétiques, exostoses, ulcères et carie des os, après avoir essayé onze fois le traitement mercuriel, fut radicalement guéri par le bois de gaïac, au bout de trente jours. Ce bois de gaïac fut donc reçu comme un bienfait du ciel, mais on ne tarda pas à s?apercevoir que ce bienfait avait aussi de graves inconvénients: aux accidents vénériens succédait souvent une consomption mortelle. Néanmoins, le bois de gaïac conserva de nombreux partisans jusqu?à ce qu?il fût détrôné par un autre [25]bois provenant aussi de l?Amérique, et nommé par les naturels du pays hoaxacan, que les Européens appelèrent bois saint (sanctum lignum). Le dernier remède eut plus de vogue en France que partout ailleurs; et, pendant une partie du seizième siècle, on fit une immense consommation de ce bois aromatique, qui justifia fréquemment son bienheureux nom par des cures extraordinaires. On faisait infuser pendant vingt-quatre heures une livre de saint-bois coupé en morceaux ou râpé; la décoction se prenait à jeun, quinze ou trente jours de suite, et procurait des sueurs abondantes qui diminuaient l?âcreté du mal et l?entraînaient quelquefois avec elles. Les médecins français ont écrit plusieurs traités sur l?efficacité du gaïac et du bois-saint; ils en parlent avec une sorte de respect et de pieuse admiration, mais ils ne font d?ailleurs que répéter les éloges qu?Ulric de Hutten, en Allemagne, et François Delgado, en Italie, avaient accordés les premiers à ce merveilleux spécifique, en reconnaissance de leur guérison. «O saint bois! disait dans ses oraisons un patient qui se trouvait soulagé, sinon guéri, par les heureux effets de ce médicament, ô saint bois, n?es-tu pas au propre le bois bénit de la croix du bon larron!» La guérison obtenue par le saint-bois ou par le gaïac n?était pourtant pas si radicale, que les traces de la maladie disparussent tout à fait: on reconnaissait à des signes trop certains les infortunés qui [26]avaient échappé à l?action aiguë du mal, sans pouvoir se soustraire à son travail incessant et mystérieux. Voici le sombre tableau que fait de ces prétendus convalescents l?auteur anonyme du Triumphe de la très-haute et très-puissante dame Vérole: «Les uns boutonnants, les autres refonduz et engraissez, les autres pleins de fistules lachrimantes, les autres tout courbez de gouttes nouées.» Le même auteur, qui s?efforçait d?enseigner la continence et la sagesse à ses lecteurs en leur offrant «l?exemple des malheureux qui tombent par leur luxure dissolue aux accidents dessusdits,» leur représente ainsi les préliminaires non moins effrayants du mal de Naples: «Les aultres estant encore aux faulxbourgs de la vérole, bien chargez de chancres, pourreaux, filets, chauldespisses, bosses chancreuses, carnositez superflues et aultres menues drogues, que l?on acquiert et amasse au service de dame Paillardise.» Longtemps avant que ce singulier ouvrage eût été publié à Lyon (1539) sous le pseudonyme de Martin Dorchesino, la poésie française s?était emparée de ce lamentable sujet, que Jérôme Fracastor devait célébrer dans son beau poëme virgilien et vénérien, qui porte le nom de la maladie elle-même (Syphilis sive morbus gallicus). Jean Droyn, d?Amiens, bachelier ès lois, poëte connu par deux poëmes moraux et chrétiens, la Nef des fols du monde et la Vie des Trois Maries, composa une ballade en l?honneur de la grosse vérole, et cette ballade, après avoir fait le [27]tour de la France avec la maladie nouvelle, fut imprimée à Lyon, en 1512, à la fin des poésies morales de frère Guillaume Alexis, moine de Lyre et prieur de Bussy. La ballade de maître Jean Droyn est fort curieuse en ce qu?elle accuse la Prostitution d?avoir répandu en France le mal de Naples, que le poëte met sur la conscience des Lombards. D?où l?on peut conclure que les guerres de Louis XII en Italie avaient été encore plus funestes à la santé de ses sujets, que la première expédition de Charles VIII. Nous croyons que la citation de cette pièce de vers ne sera pas déplacée ici, comme un monument de la joyeuse philosophie de nos ancêtres en matière de peste et de plaisir.
Histoire de la prostitution chez tous les
Sobre
Talvez você seja redirecionado para outro site