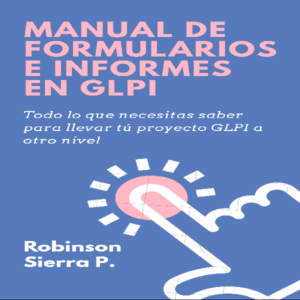Extrai:
Si mon fils est tué, je me tue.
Il doit arriver au front aujourd’hui.
Désormais, à chaque minute, je peux apprendre une affreuse nouvelle.
Ah ! J’envie presque ces femmes, autour de moi, qui, tout en tremblant pour un être aimé, admettent la guerre, s’y résignent, la croient nécessaire, imposée, la voient belle et glorieuse. Au moins, leur foi les aide à supporter l’angoisse. Mais moi, qui hais, qui vomis la guerre, moi qui m’imagine connaître ceux qui, dans chaque pays, l’allumèrent et l’entretiennent, moi qui suis obligée de vivre aux côtés d’un de ces hommes, ne suis-je pas plus à plaindre que les autres femmes ?
Un seul espoir me soutient : l’espoir de la paix. Il m’aide à vivre. J’en ai encore senti le réconfort ce matin, juste au lendemain du départ de mon René, quand j’ai appris l’initiative des États-Unis, qui demandent à tous les belligérants leurs buts de guerre. Si c’était la médiation, la fin ?…
Je n’ose pas y croire. Je me rappelle, il y a dix jours, les propositions de paix de l’Allemagne. Avant même d’en connaître la teneur, on les a piétinées, enfouies. Mon mari, ses pareils, tous les grands féodaux du métal, de la haute industrie, ont donné le mot d’ordre et l’exemple, suivi le lendemain par la presse et le pouvoir. Mais va-t-on traiter aussi dédaigneusement l’Amérique, oublier qu’elle peut, en se jetant dans l’un ou l’autre camp, décider du conflit ?
Le comique et l’atroce, c’est que je dois garder pour moi mes craintes et mes espérances. Je ne peux les confier à personne, sauf à mon vieil ami Paron, qui pense comme moi. Sans lui, je serais seule, toute seule, parmi les centaines de gens que je coudoie. Qui le croira, plus tard ? Après trente mois d’une guerre sans exemple, pour une maman, c’est une honte, un crime, d’appeler la paix !
Si mon fils est tué, je me tue.
Il doit arriver au front aujourd’hui.
Désormais, à chaque minute, je peux apprendre une affreuse nouvelle.
Ah ! J’envie presque ces femmes, autour de moi, qui, tout en tremblant pour un être aimé, admettent la guerre, s’y résignent, la croient nécessaire, imposée, la voient belle et glorieuse. Au moins, leur foi les aide à supporter l’angoisse. Mais moi, qui hais, qui vomis la guerre, moi qui m’imagine connaître ceux qui, dans chaque pays, l’allumèrent et l’entretiennent, moi qui suis obligée de vivre aux côtés d’un de ces hommes, ne suis-je pas plus à plaindre que les autres femmes ?
Un seul espoir me soutient : l’espoir de la paix. Il m’aide à vivre. J’en ai encore senti le réconfort ce matin, juste au lendemain du départ de mon René, quand j’ai appris l’initiative des États-Unis, qui demandent à tous les belligérants leurs buts de guerre. Si c’était la médiation, la fin ?…
Je n’ose pas y croire. Je me rappelle, il y a dix jours, les propositions de paix de l’Allemagne. Avant même d’en connaître la teneur, on les a piétinées, enfouies. Mon mari, ses pareils, tous les grands féodaux du métal, de la haute industrie, ont donné le mot d’ordre et l’exemple, suivi le lendemain par la presse et le pouvoir. Mais va-t-on traiter aussi dédaigneusement l’Amérique, oublier qu’elle peut, en se jetant dans l’un ou l’autre camp, décider du conflit ?
Le comique et l’atroce, c’est que je dois garder pour moi mes craintes et mes espérances. Je ne peux les confier à personne, sauf à mon vieil ami Paron, qui pense comme moi. Sans lui, je serais seule, toute seule, parmi les centaines de gens que je coudoie. Qui le croira, plus tard ? Après trente mois d’une guerre sans exemple, pour une maman, c’est une honte, un crime, d’appeler la paix !